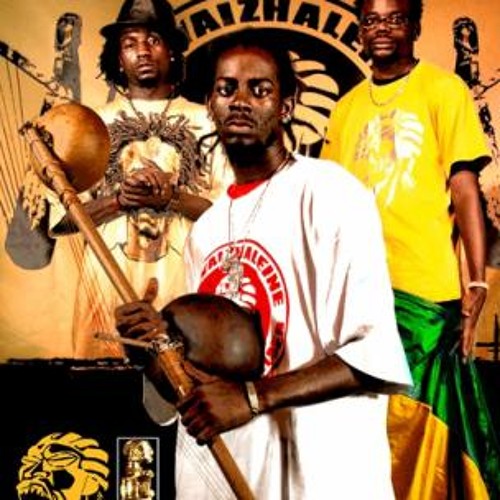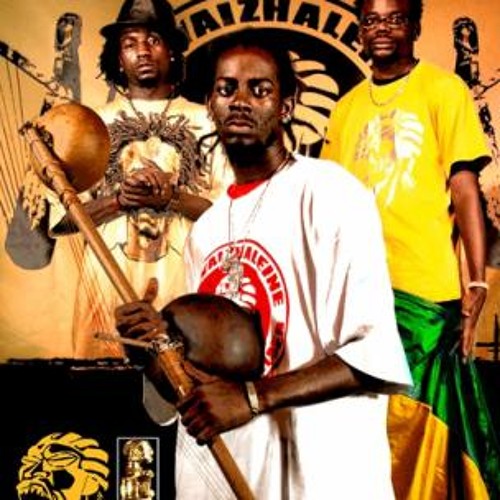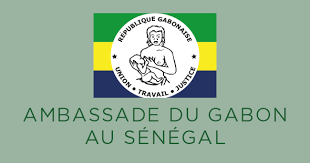- Par BOUTET Orphé
- 30-11-2023
Le rôle du rap gabonais dans les...
Les élections de 2016 : désillusion, escalade et dénouement sanglant
Cependant, malgré le bénéfice du doute accordé, et un prix du baril de pétrole historiquement élevé, le septennat d’Ali rimera avec désillusion, prédation des finances publiques et paupérisation exponentielle de la population. De quoi ajouter de l’eau au moulin des rappeurs engagés. Avant même qu’une véritable opposition politique s’organise formellement, la contestation des rappeurs va porter des estocades lyricales au régime émergent. Ainsi, le rappeur Keurtyce E, vent debout, va s’en prendre au président Ali dans le très explicite On va tourner la page dans lequel il revendique haut et fort le changement au sommet de l’Etat, au risque d’un soulèvement populaire post-électoral. Morceaux choisis : « T’es pas Dieu, t’es pas notre maître/Essaie, tu vas apprendre à nous connaître », « Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça/Si tu restes au palais c’est tant pis pour toi ». Une double remarque peut être faite sur la portée symbolique du message de la rue que véhiculent ces vers. D’une part, le tutoiement de la plus haute autorité, symbole de son désaveu par les masses populaires qui n’ont plus aucun respect pour le président devenu despote qui a, par son comportement indigne durant le septennat, désacralisé la fonction présidentielle. D’autre part, ces paroles traduisent ce que prépare la population : un soulèvement en cas de nouveau vol électoral ; la violence des mots préfigure la résolution ferme de la population d’en découdre, avec une intensité plus élevée qu’en 2009. On voit ainsi que les paroles des artistes rappeurs, à l’image de ce titre de Keurtyce E, sont une sorte de thermomètre qui pourrait servir au mélomane avisé à prendre la température du peuple. Mais malheureusement les politiques ont souvent fait le choix de casser le thermomètre plutôt que de le lire. D’où l’exil massif des artistes contestataires, à la quête d’un meilleur avenir ou pour fuir la répression. C’est le cas du rappeur Sayk’1ry qui depuis le sud de la France écrira le très corrosif Mister zéro, périphrase désignant Ali et son bilan catastrophique. Ce texte bilan, se donne pour mission de passer au crible le septennat d’Ali. Là aussi les vers sont sans ambiguïté : « En 2009 tu nous as promis ciel et terre/Un avenir en confiance pour les fils des prolétaires […] /Sept ans après on fait le bilan : zéro/Combien d’écoles ? zéro/Combien de collèges et des lycées sortis de sol ? zéro/ Universités ? Une bibliothèque ?zéro/Que des discours et des discours et des maquettes ! Zéro ! ». Au cœur des élections de 2016, un collectif mené par Lord Ekomy Ndong, Maat Seigneur Lion et Lestaat XXL va poursuivre cette logique avec le titre On ne te suit pas (en réaction au titre « On te suit » des artistes propagandistes menés par le groupe Hayoe). Cette opposition de style très clivante traduit le climat explosif des élections de 2016 : une population remontée à bloc (alignée derrière l’opposant Ping) contre une petite « élite » qui tient illégitimement les rênes du pouvoir. Ce qui devait arriver arriva. Un nouveau vol électoral. Mais cette fois il est suivi d’un soulèvement populaire avec comme point d’orgue l’incendie de l’assemblée nationale par le peuple floué. Une fois de plus. Une fois de trop. La répression sanglante qui s’en suivra (assassinats collectifs et bombardement du quartier général de l’opposant Ping) sera sans précédents dans la jeune histoire électorale du pays. Et pourtant les rappeurs cités supra avaient prémonitoirement annoncé ces évènements morbides. Keurtyce E annonçait déjà : « La rumeur court que tu prépares la guerre/Président mal élu et impopulaire/Clandestinement tu fais entrer des armes/Après les élections il y aura du sang et des flammes. ». Et Sayk’1ry : «Mister zéro et compagnie nous préparent déjà la guerre ». Comme quoi, à l’instar du poète hugolien (Fonction du poète, Les Rayons et les ombres, 1840), le rappeur a également parfois une dimension prophétique dans sa fonction de lanceur d’alerte. Ce dénouement sanglant va marquer un tournant dans l’attitude des rappeurs engagés gabonais. Tout d’abord il y a le temps du deuil et des larmes. A l’instar du pays qui pleurera longtemps ses héros, la scène rapologique va prendre le temps pour pleurer ; le rap se mue alors en catharsis. Un texte pourrait résumer cet état : Rouges nuages de Lord Ekomy Ndong (encore lui). Le lyriciste utilise dans ce son la métaphore climatique et l’élégie pour traduire la douleur du peuple et dénoncer la liste non exhaustive des martyrs de la nation (depuis la période pré-électorale et celle post-électorale) : « Quand les nuages deviennent rouges,/ Quel genre de pluie tombe/ Quelle genre de foudre frappe/ Quel genre de tonnerre gronde/Quel genre de démocrate compte sur les armes et les cagoules/Combien de toits s’effondrent/Combien de larmes coulent ?/Nos familles sortent des bureaux de vote pour faire du porte à porte/ de morgues en morgues/Rendez les corps ! Que s’est-il passé ? Assassinats tout tracé/Victimes ramassées, traces effacées/Affaire classée ! ». A cette tendance élégiaque, succèdera la colère et le devoir de mémoire. Les rappeurs se muent en gardiens des faits historiques. C’est ce que reflète l’hommage testimonial que rendent Lestaat XXL et Lord Ekomy Ndong dans le titre Sur mon drapeau. Dans ce titre les rappeurs accusent le politique d’avoir sali la bannière tricolore nationale : elle est désormais maculée du sang des martyrs. Ce texte à charge, est là donc pour rappeler aux bourreaux que cette tâche coupable restera indélébile. Plus rien ne sera comme avant : « Vous pouvez vous voiler la face mais vous verrez bien plus rien ne sera comme avant/Ne change pas de sujet, j’étais au Q.G. pendant que tu étais en train de nang[…] La question à l’heure actuelle est plus morale que politique[…]/Vous ne faites pas, donc on met nous-même nos morts en haut/Le vert jaune bleu est en lambeau/Merci à Mme Mbourantso ! ». Pour mieux mesurer l’étendue de ce deuil et cette révolte du milieu rap, il faudra constater le changement de position de certains rappeurs jugés jusque-là proche du pouvoir en place. Le cas le plus sensationnel est la volte-face du poids lourd Kôba. Il va faire ce qu’on pourrait appeler son « coming-out » subversif antisystème avec le titre Odjuku. Depuis son exil français, le rappeur s’en prend aux origines étrangères et étranges du dictateur Ali (sa nationalité gabonaise a toujours été contestée). Loin d’être un texte xénophobe et haineux, le titre de Kôba est un véritable exercice de style qui combine les attaques ad personam légères (« Odjuku, on ne te suit pas, shiba-man », «Tu n’es pas beau, tu n’es pas intelligent/Tu es un très mauvais dirigeant ») et des vers plus graves et incisifs (« Le peuple est en deuil, Odjuku, entends-tu les pleurs ? », « Les panthères sont debout la main sur les cœurs/Tu peux tirer sur nous, jamais l’idée ne meurt »). Cette fêlure immarcescible laissée par la répression sanglante de 2016 dans les corps et les esprits va marquer un point de non-retour entre le peuple (et en l’occurrence les rappeurs) meurtri et le président meurtrier. Ce clivage préparait donc le lit d’une parole rapologique encore plus virulente pour les élections suivantes
Par Eudes Ilotse