-

-
-
Chargement
 Gabon Veille
Gabon Veille

Du contenu et de la durée de la Transition au Gabon : la parole au peuple souverain ! (1ere Partie)
- Par BOUTET Orphé,
- Mise à jour le 22-11-2023
« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi », disaient l’un et l’autre, sinon en chœur, Gandhi et Nelson Mandela. Ils entendaient ainsi mettre en relief l’importance de la consultation et de l’implication des bénéficiaires, dans la conception et la réalisation d’une action ou d’un projet, et donc l’exigence de promotion de la participation citoyenne et de la démocratie participative.
L’avènement du « coup de liberté » du Général Oligui Nguéma et de ses pairs a davantage libéré la parole populaire. Longtemps ignorée, instrumentalisée, minorée sinon bâillonnée, la voix du peuple gabonais souverain a dorénavant besoin de se faire entendre. En témoignent, les réactions citoyennes nombreuses, à travers les réseaux sociaux, des actions du président et du gouvernement de la Transition. Ce qui cristallise, ces derniers temps, cette parole populaire, avide d’expectorer sa libération et son désir d’être dorénavant écoutée et entendue, est la durée de la Transition[1]. Mais, au-delà de la durée de la Transition, les citoyens et citoyennes se prononcent également sur son contenu, sa feuille de route, c’est-à-dire sur les priorités qui devraient être les siennes. En réaction à ces paroles citoyennes véhiculées par les réseaux sociaux, JKM, auteur d’un article dans L’Union du vendredi 17 novembre courant, place « le peuple gabonais face à ses responsabilités » en invitant les citoyennes et les citoyens à s’exprimer plutôt dans le « cadre formel » de la consultation initiée par le gouvernement et de la tenue du dialogue national prévu en avril prochain, déclinées par le chronogramme officiel de la « Transition politique au Gabon ».
Une consultation citoyenne préparatoire au dialogue national mal engagée
Tout en saluant le principe de ladite consultation en cours et du dialogue national envisagé, nous considérons, cependant, que ces deux initiatives n’atteindront pas leur objectif avoué, à savoir : donner réellement la parole au peuple gabonais, permettre à ce dernier d’exprimer ses aspirations et ses attentes, c’est-à-dire l’impliquer véritablement dans la définition et la construction des fondations de son « essor vers [sa] félicité » à venir. L’initiative louable du CTRI de « faire à nouveau parler les Gabonais qui en avaient perdu l’habitude » est très mal engagée et s’apparente déjà à une énième instrumentalisation de la parole populaire. On ne peut, à la fois, vouloir libérer la parole du peuple et en même temps la corseter.
Pour libérer la parole des Gabonais, il aurait fallu organiser la consultation populaire préparatoire au dialogue national différemment en partant de la base, c’est-à-dire en recueillant les doléances des citoyennes et citoyens par village et par quartier ; par canton et par arrondissement ; par département et par province. Les chefs de village et de quartier ; les sous-préfets, préfets et gouverneurs auraient été les organisateurs délégués desdites consultations. Ces consultations directes auraient eu le mérite de faire parler surtout les populations rurales et non lettrées incapables d’utiliser la médiation électronique proposée par le portail officiel « MBOVA ».
Eviter une infantilisation des citoyens
Par ailleurs, le fait de définir par avance les thèmes de la discussion est une façon justement de corseter cette parole populaire qu’on est censé émanciper. C’est tout le contraire du « coup de liberté ». On pourrait avoir le sentiment de quitter une camisole pour une autre. Le meilleur moyen de « faire à nouveau parler les Gabonais qui en avaient perdu l’habitude » aurait été de libérer totalement leur parole, de leur donner l’occasion de « vider leur sac », dans le cadre de discussions organisées à la base. Encadrer d’avance cette parole populaire en définissant un format et en circonscrivant des thèmes précis, au prétexte de prévenir des débordements est, en réalité, une infantilisation des citoyennes et de citoyens gabonais. Il y a, dans ce procédé, une forme de condescendance élitiste des hommes et des femmes politiques et des représentants de la société dite civile qui s’arrogent le droit de penser et de parler à la place des populations. A ce jour et dans le contexte de la Transition, la question nationale, avant d’être une question d’institutions et de leur réforme, est d’abord et avant tout une question de mal-vivre. Ce mal-vivre, qui d’autre peut en témoigner et en parler concrètement que le peuple lui-même ? Qui d’autres que les populations de Moulengui-Binza, dans le département de Mongo, parleraient mieux du besoin d’avoir une route de qualité en toute saison ? Qui d’autres que les populations d’Ikobey, dans le département de Tsamba-Magotsi, pour parler des besoins d’une médecine de proximité, en termes d’infrastructures et de personnel de santé ? Qui mieux que les populations de Kinguélé et autres Bangos, à Libreville, pour parler des problèmes d’insécurité ? Qui mieux que les jeunes sans emplois, en milieu urbain ou en milieu rural, pour parler du chômage de la jeunesse ? Qui d’autres que les usagers de l’administration ou de la circulation pour parler de la « petite corruption » qui gangrène notre société ?
Par Stephane Vouillé
[1] Cf. L’article « Chronogramme de la Transition : le peuple gabonais face à ses responsabilités » in L’Union n° 14380 du vendredi 17 novembre 2023, signé JKM en page 5, mais aussi le micro-trottoir de Gabon Media Times en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=hk0KKwvO25Y.





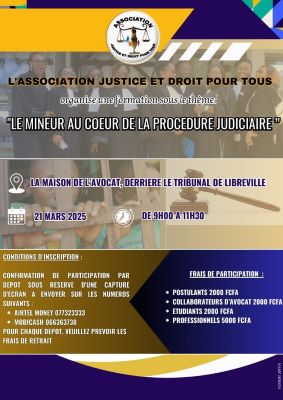

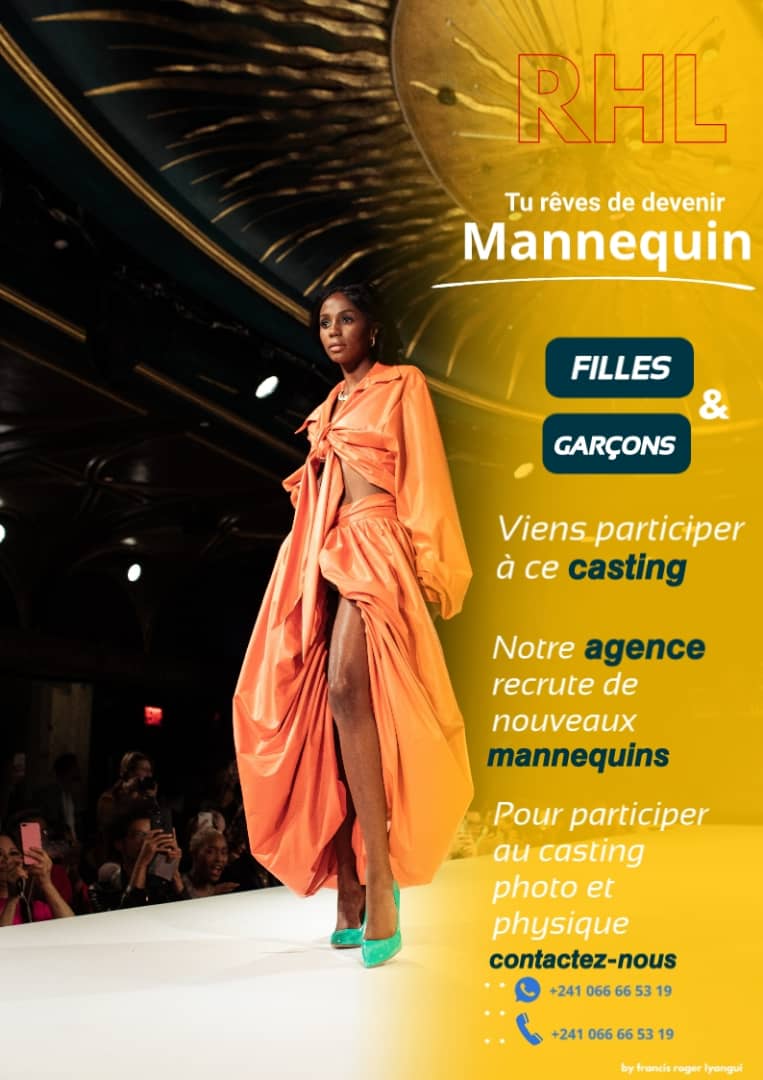









0 Commentaire(s):
Laisser un commentaire