-

-
-
Chargement
 Gabon Veille
Gabon Veille

Brice Clotaire Oligui Nguéma : l’homme providentiel que le Gabon attendait ? (2ème partie)
- Par BOUTET Orphé,
- Mise à jour le 15-04-2024
Homme providentiel : de quoi parle-t-on
Si nous nous limitons aux extraits cités ci-dessus, nous remarquons que les panégyristes et les critiques d’Oligui Nguéma, en réalité, n’ont pas la même acception de la notion d’« homme providentiel ». Pour les premiers, l’homme providentiel est un rebelle et un patriote qui entre en scène en ouvrant, pour son peuple, une nouvelle ère attendue de ce dernier. Pour les seconds, l’homme providentiel est un « homme fort », et sans doute incarnant un pouvoir personnalisé et autoritaire. Chez les critiques, la réserve émise à l’égard de l’homme providentiel laisse suppose que le pouvoir personnalisé et autoritaire dudit homme n’est jamais et ne sera jamais exempt de dérives. En présageant un échec de la Transition, dans le cas où elle déboucherait sur la consécration du pouvoir d’un homme providentiel, les critiques laissent entendre, par ailleurs, que l’ère des hommes providentiels est celle du passé : cette époque doit prendre fin.
Avant d’être préemptée par le Gabon, et l’Afrique en général, cette notion d’homme providentiel a d’abord une histoire occidentale. En l’occurrence, l’histoire de l’Italie de la Renaissance, en proie à des guerres fratricides dont les conséquences sont la désunion et le risque d’implosion nationale. Dans ce contexte de crise, l’homme providentiel espéré et attendu est celui qui réussit à fédérer les différentes factions militaires et politiques et à reconstruire l’unité nationale italienne. Pour l’Italie de la Renaissance, cet homme providentiel s’est incarné le mieux dans la figure de Francesco Sforza (1401-1466), prince guerrier, duc de Milan. Dans cet exemple italien, il est clair que l’homme providentiel, enfant d’une crise, est un patriote qui doit faire montre d’une autorité certaine s’imposant à tous.
Pour Jean Garrigues, spécialiste du sujet, l’histoire de France est aussi riche en « hommes providentiels ». Dans cette histoire française, « le mythe de l’homme providentiel et celui du sauveur se confondent […] Mais, pour être plus précis, on pourrait considérer que l’homme providentiel est un sauveur en train de se construire, une attente, un espoir, une invocation, tandis que l’image du sauveur s’appliquerait à un homme providentiel qui a réussi, en quelque sorte. Celui qui apparaît à un moment de notre histoire comme un homme providentiel devient un sauveur au moment où il a réussi son coup (c’est-à-dire la conquête du pouvoir) et qui, dès lors, connaît un état de grâce. Le sauveur – comme Napoléon Bonaparte, Georges Clemenceau ou Charles de Gaulle – est un homme providentiel qui est parvenu à ses fins. »[1]
Pour Jean Garrigues, l’homme providentiel, nécessairement révélé par une crise, est toujours en posture d’extériorité « par rapport à un système politique qu’il entend bousculer au nom du peuple. » Et quand bien même il appartiendrait audit système, il y assumerait la contenance d’un marginal, d’un dissident, d’un rebelle.
En Afrique, nous pouvons considérer schématiquement que la notion d’homme providentiel s’ « endogènise » d’abord dans le cadre des luttes pour les indépendances et ensuite dans le cadre de la construction des jeunes Etats indépendants. En tenant pour acquis que c’est la crise qui révèle l’homme providentiel, dans le cadre des luttes pour les indépendances, la crise révélatrice des hommes providentiels était la colonisation. Dans le cadre de la construction des jeunes Etats indépendants, les crises qui feront l’avènement des hommes providentiels sont les « prétendues » guerres ethniques. Nous disons « prétendues », parce que ces dernières n’ont pas toujours et partout été des crises avérées, mais quelques fois des crises fantasmées et instrumentalisées, notamment en vue de la justification de l’avènement des partis uniques, de leurs leaders-guides éclairés et des systèmes politiques autoritaires qui en découleront. Pour justifier le remplacement des régimes multipartistes par des régimes à parti unique et le recours à l'autoritarisme de ceux-là, il a été vendu l’argument de la nécessité de promouvoir et construire plus efficacement le développement socioéconomique et l'unité nationale.
Cette schématisation historique de l’appropriation par l’Afrique de ce concept d’homme providentiel, nous amène à faire la part entre deux notions : celle de l’homme providentiel médiateur, incarnée par les leaders indépendantistes et des mouvements de libération ; celle de l’homme providentiel autoritaire, incarnée par les leaders en responsabilité à la tête des jeunes Etats indépendants.
Rebelle et, de ce fait, porteur d’une noble ambition populaire visionnaire et souveraine, considérant le pouvoir comme un levier de réalisation de ladite ambition, l’homme providentiel médiateur est un passeur d’espérance et un bâtisseur de société future ouverte. En posture d’intercesseur, l’homme providentiel médiateur est le pont entre son peuple et la société dont il rêve et dans laquelle ses aspirations et besoins peuvent ou pourront être réalisés. En ce sens, l’homme providentiel est celui qui s’efforce d’être, le mieux qu’il peut, au service de l’intérêt général, sans se considérer comme indispensable. Le meilleur et illustre exemple de ce type d’homme providentiel est Nelson Mandela, héros Sud-africain de la lutte contre l’apartheid.
A l’inverse, l’homme providentiel autoritaire, sans ambition et vision précises pour son peuple et pour son pays, considère le pouvoir comme un objet de consommation et de jouissance personnelles. L'exercice du pouvoir par cet homme providentiel autoritaire est davantage marqué par l'arbitraire, le non-respect du droit, la violation des droits des humains et une gestion patrimoniale de l’Etat, sans considération de satisfaire les besoins et les aspirations des populations. Les exemples de cet homme providentiel autoritaire sont légion, en Afrique ; l’Empereur Jean Bedel Bokassa en était une des illustres caricatures.
Entre l’homme providentiel médiateur et l’homme providentiel autoritaire, il existerait, à notre avis, une autre posture : celle de l’homme providentiel pragmatique.
Tout aussi rebelle que l’homme providentiel médiateur, parce que mû par une ambition sous-tendue par des valeurs patriotiques, l’homme providentiel pragmatique exerce un pouvoir autoritaire comme moyen et levier pour impulser le développement de son pays et satisfaire les besoins et aspirations populaires. Révélé par le drame du génocide des Tutsi et inspiré par le leader singapourien Lee Kuan Yew, exemple d’homme providentiel pragmatique asiatique, Paul Kagame est un exemple africain d’homme providentiel pragmatique.
Par Stephane Vouillé





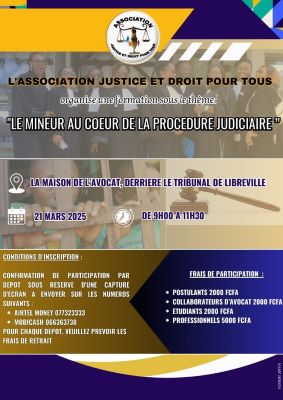

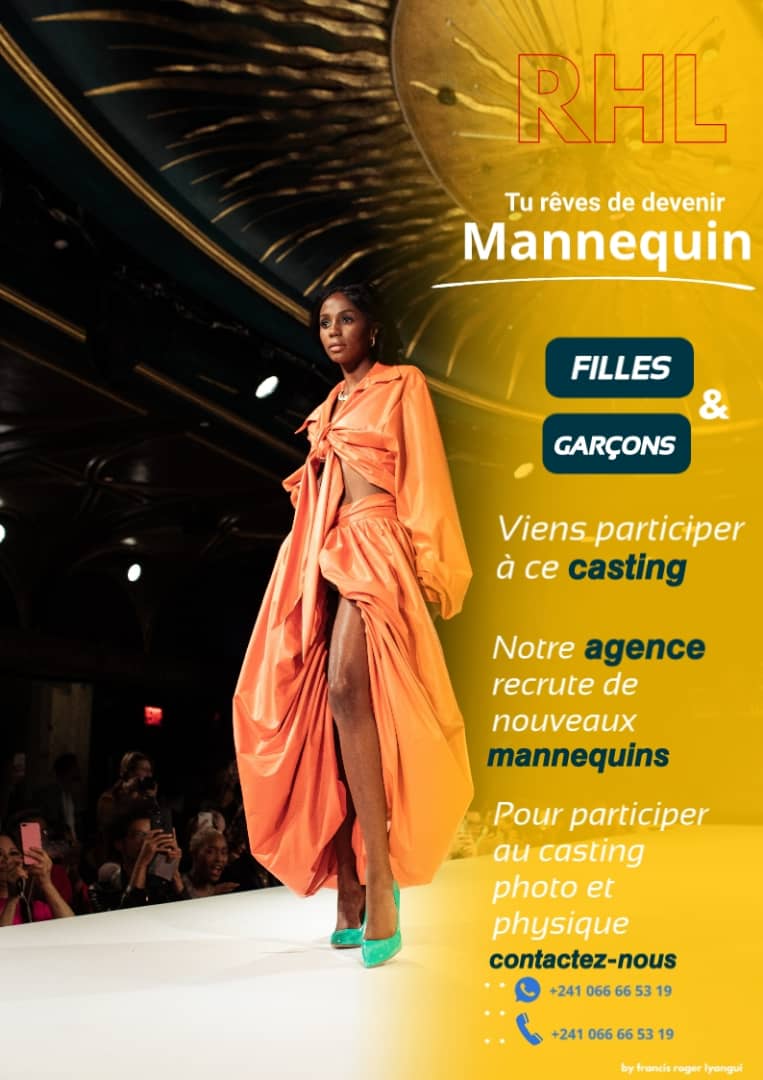






3 Commentaire(s):
Laisser un commentaire